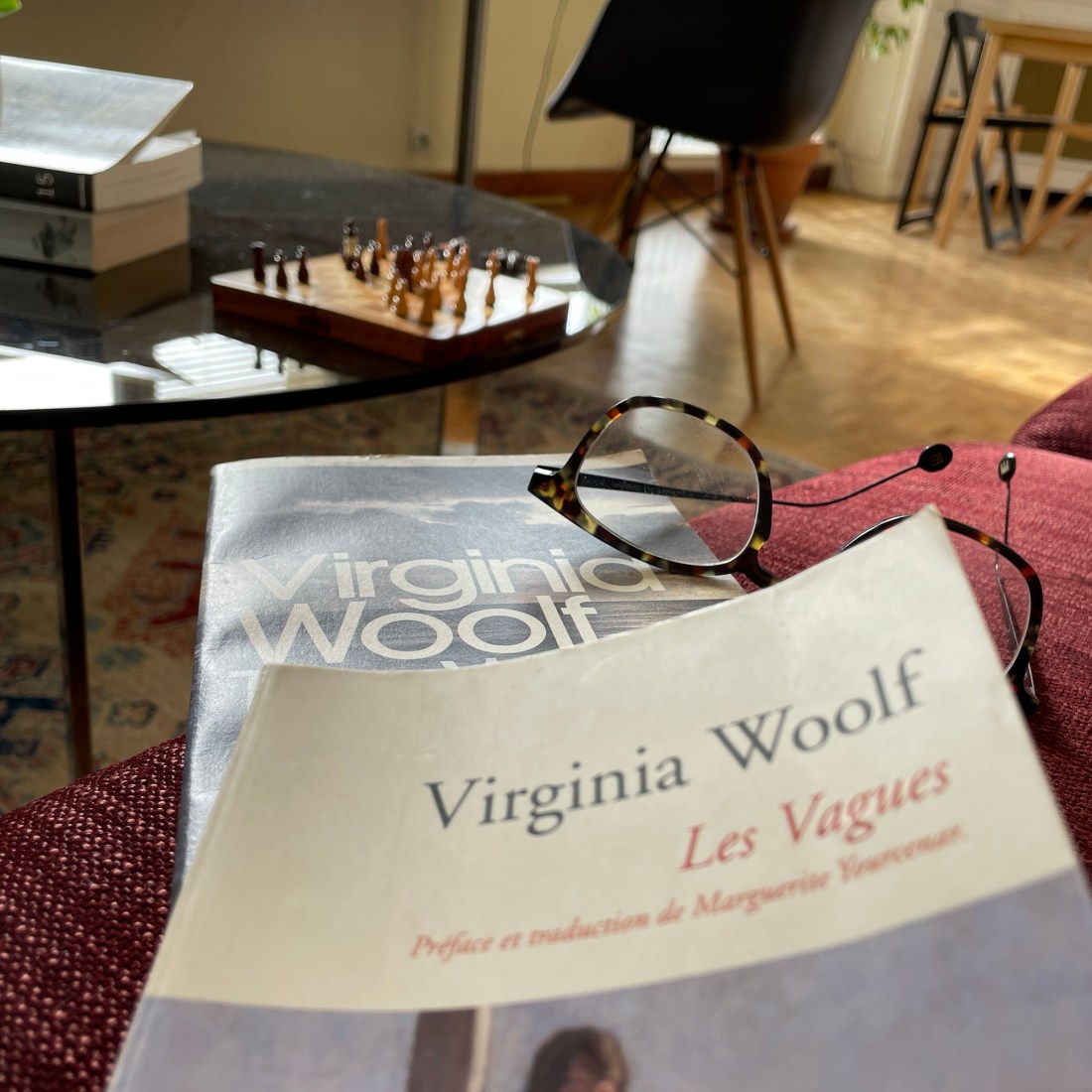À nos heures contrites où nous savons tout et nous ne croyons plus en rien, n’y aurait-il pas une autre science à inventer? N’y aurait-il pas un nouveau commencement? Ne pourrions-nous pas être à nouveau « nous, nouveaux, sans nom*« ? Ne pourrions-nous pas être à nouveau impatients, intranquilles, insomniaques, avides? Je perçois l’économie générale de la chose. Je perçois la balance générale, quand je veux passionnément être l’autre qui est en face de moi. Quand je sens jusqu’à la douleur tout le commencement qui dort en lui ou en elle. Quand ceci, le subtil équilibre de l’âme, le subtil équilibre d’une âme, occupe peu à peu tout le temps et tout l’espace. Cette accélération. J’ai souvent appelé cela amour, parfois à raison, parfois à tort. Ou séduction, chimie, échanges, économie. Aujourd’hui je nommerais cela, avant un hypothétique scientifique, énergie. Transfert, échange, transmutation, création et altération d’énergie. La vie, et la vie de l’âme, ce n’est rien d’autre et il faut voir toute la noblesse de la chose. D’où vient le feu qui brûle en nous? On ne sait pas mais il faut l’extirper, le sortir. Il faut avidemment se saisir de matériaux de toutes sortes, sensibles, matériels, ésotériques, abstraits, fictifs, affectifs, prétendus pour brûler. Il nous faut la « grande santé » de l’aphorisme #382 du Gai Savoir de Nietzsche.
—
« 382*.
La grande santé. — Nous autres hommes nouveaux, innommés, difficiles à comprendre, précurseurs d’un avenir encore non démontré — nous avons besoin, pour une fin nouvelle, d’un moyen nouveau, je veux dire d’une nouvelle santé, d’une santé plus vigoureuse, plus aiguë, plus endurante, plus intrépide et plus joyeuse que ne furent jusqu’à présent toutes les santés. Celui dont l’âme est avide de faire le tour de toutes les valeurs qui ont eu cours et de tous les désirs qui ont été satisfaits jusqu’à présent, de visiter toutes les côtes de cette « méditerranée » idéale, celui qui veut connaître, par les aventures de sa propre expérience, quels sont les sentiments d’un conquérant et d’un explorateur de l’idéal, et, de même, quels sont les sentiments d’un artiste, d’un saint, d’un législateur, d’un sage, d’un savant, d’un homme pieux, d’un devin, d’un divin solitaire d’autrefois : celui-là aura avant tout besoin d’une chose, de la grande santé — d’une santé que non seulement on possède mais qu’il faut aussi conquérir sans cesse, puisque sans cesse il faut la sacrifier !… Et maintenant, après avoir été ainsi longtemps en chemin, nous, les Argonautes de l’Idéal, plus courageux peut-être que ne l’exigerait la prudence, souvent naufragés et endoloris, mais mieux portants que l’on ne voudrait nous le permettre, dangereusement bien portants, bien portants toujours à nouveau, — il nous semble avoir devant nous, comme récompense, un pays inconnu, dont personne encore n’a vu les frontières, un au-delà de tous les pays, de tous les recoins de l’idéal connus jusqu’à ce jour, un monde si riche en choses belles, étranges, douteuses, terribles et divines, que notre curiosité, autant que notre soif de posséder sont sorties de leurs gonds, — hélas ! que maintenant rien n’arrive plus à nous rassasier ! Comment pourrions-nous, après de pareils aperçus et avec une telle faim dans la conscience, une telle avidité de science, nous satisfaire encore des hommes actuels ? C’est assez grave, mais c’est inévitable, nous ne regardons plus leurs buts et leurs espoirs les plus dignes qu’avec un sérieux mal tenu, et peut-être ne les regardons-nous même plus. Un autre idéal court devant nous, un idéal singulier, tentateur, plein de dangers, un idéal que nous ne voudrions recommander à personne, parce qu’à personne nous ne reconnaissons facilement le droit à cet idéal : c’est l’idéal d’un esprit qui se joue naïvement, c’est-à-dire sans intention, et parce que sa plénitude et sa puissance débordent, de tout ce qui jusqu’à présent s’est appelé sacré, bon, intangible, divin ; pour qui les choses les plus hautes qui servent, avec raison, de mesure au peuple, signifieraient déjà quelque chose qui ressemble au danger, à la décomposition, à l’abaissement ou bien du moins à la convalescence, à l’aveuglement, à l’oubli momentané de soi ; c’est l’idéal d’un bien-être et d’une bienveillance humains-surhumains, un idéal qui apparaîtra souvent inhumain, par exemple lorsqu’il se place à côté de tout ce qui jusqu’à présent a été sérieux, terrestre, à côté de toute espèce de solennité dans l’attitude, la parole, l’intonation, le regard, la morale et la tâche, comme leur vivante parodie involontaire — et avec lequel, malgré tout cela, le grand sérieux commence peut-être seulement, le véritable problème est peut-être seulement posé, la destinée de l’âme se retourne, l’aiguille marche, la tragédie commence… »
—
« 382.
Die grosse Gesundheit. – Wir Neuen, Namenlosen, Schlechtverständlichen, wir Frühgeburten einer noch unbewiesenen Zukunft – wir bedürfen zu einem neuen Zwecke auch eines neuen Mittels, nämlich einer neuen Gesundheit, einer stärkeren gewitzteren zäheren verwegneren lustigeren, als alle Gesundheiten bisher waren. Wessen Seele darnach dürstet, den ganzen Umfang der bisherigen Werthe und Wünschbarkeiten erlebt und alle Küsten dieses idealischen « Mittelmeers » umschifft zu haben, wer aus den Abenteuern der eigensten Erfahrung wissen will, wie es einem Eroberer und Entdecker des Ideals zu Muthe ist, insgleichen einem Künstler, einem Heiligen, einem Gesetzgeber, einem Weisen, einem Gelehrten, einem Frommen, einem Wahrsager, einem Göttlich-Abseitigen alten Stils: der hat dazu zuallererst Eins nöthig, die grosse Gesundheit – eine solche, welche man nicht nur hat, sondern auch beständig noch erwirbt und erwerben muss, weil man sie immer wieder preisgiebt, preisgeben muss!… Und nun, nachdem wir lange dergestalt unterwegs waren, wir Argonauten des Ideals, muthiger vielleicht, als klug ist, und oft genug schiffbrüchig und zu Schaden gekommen, aber, wie gesagt, gesünder als man es uns erlauben möchte, gefährlich-gesund, immer wieder gesund, – will es uns scheinen, als ob wir, zum Lohn dafür, ein noch unentdecktes Land vor uns haben, dessen Grenzen noch Niemand abgesehn hat, ein jenseits aller bisherigen Länder und Winkel des Ideals, eine Welt so überreich an Schönem, Fremdem, Fragwürdigem, Furchtbarem und Göttlichem, dass unsre Neugierde ebensowohl wie unser Besitzdurst ausser sich gerathen sind – ach, dass wir nunmehr durch Nichts mehr zu ersättigen sind! Wie könnten wir uns, nach solchen Ausblicken und mit einem solchen Heisshunger in Gewissen und Wissen, noch am gegenwärtigen Menschen genügen lassen? Schlimm genug: aber es ist unvermeidlich, dass wir seinen würdigsten Zielen und Hoffnungen nur mit einem übel aufrecht erhaltenen Ernste zusehn und vielleicht nicht einmal mehr zusehn. Ein andres Ideal läuft vor uns her, ein wunderliches, versucherisches, gefahrenreiches Ideal, zu dem wir Niemanden überreden möchten, weil wir Niemandem so leicht das Recht darauf zugestehn: das Ideal eines Geistes, der naiv, das heisst ungewollt und aus überströmender Fülle und Mächtigkeit mit Allem spielt, was bisher heilig, gut, unberührbar, göttlich hiess; für den das Höchste, woran das Volk billigerweise sein Werthmaass hat, bereits so viel wie Gefahr, Verfall, Erniedrigung oder, mindestens, wie Erholung, Blindheit, zeitweiliges Selbstvergessen bedeuten würde; das Ideal eines menschlich-übermenschlichen Wohlseins und Wohlwollens, das oft genug unmenschlich erscheinen wird, zum Beispiel, wenn es sich neben den ganzen bisherigen Erden-Ernst, neben alle Art Feierlichkeit in Gebärde, Wort, Klang, Blick, Moral und Aufgabe wie deren leibhafteste unfreiwillige Parodie hinstellt – und mit dem, trotzalledem, vielleicht der grosse Ernst erst anhebt, das eigentliche Fragezeichen erst gesetzt wird, das Schicksal der Seele sich wendet, der Zeiger rückt, die Tragödie beginnt… »