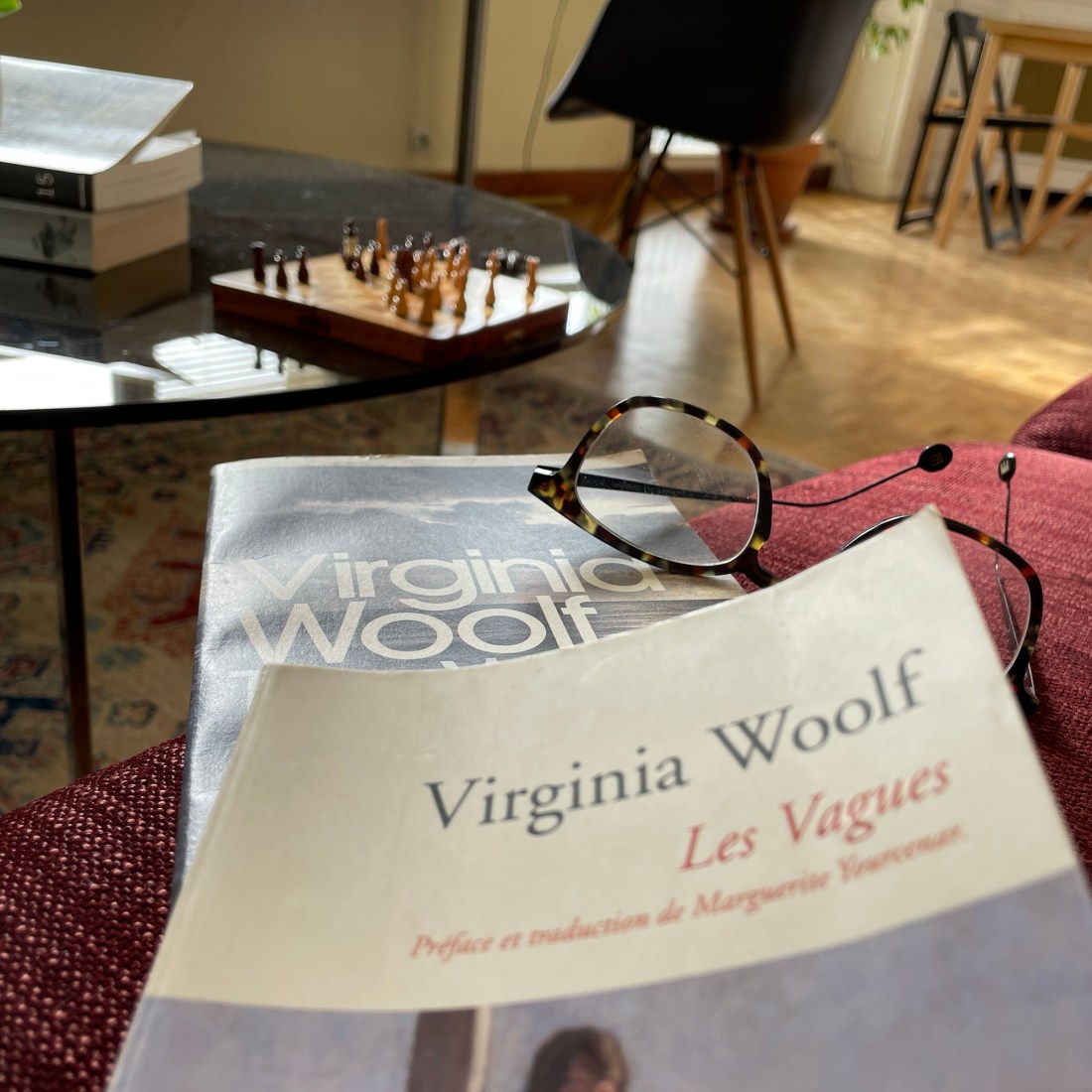‘La fine pointe de l’âme, acumen mentis, ne sera jamais assez effilée ni assez aiguë pour effleurer la fine pointe de l’événement : la tangence de cette pointe impondérable avec ce point impalpable – voilà la visée acrobatique de tout esprit de finesse…’
Vladimir Jankélévitch, ‘L’irréversible et la nostalgie’, 1974
L’observateur s’illusionne. L’observateur se leurre. Il se pique d’avoir une distance qu’il n’a pas sur les êtres et les choses, sur les évènements et sur lui-même. Il voudrait regarder passer les trains avec un petit sourire, en remâchant tranquillement ses idées, mais malheureusement il est embarqué dans le train avec les autres, avec tous les autres. Il se gave de lectures qu’il digère mal. Dans son cerveau embrumé se bousculent des démarrages magnifiques qui s’étranglent, des tronçons de phrases qui dérapent comme des chihuahuas hargneux sur l’actualité glissante. Mais il faut bien essayer, encore et encore. Il faut raconter.
Car enfin, qu’avons-nous vu? On ne sait plus trop. On est dans le contrecoup, la sidération, l’œil du cyclone stupide de l’évènement. Celui-ci a été tellement dupliqué, lessivé, délayé, amplifié, déformé qu’il s’est instantanément transformé en légende, comme une matière rare et captive qui ne supporterait le contact de l’air et de la lumière qu’au prix d’une mutation profonde. Passagers du temps, nous n’y comprenons rien, quand bien même il nous est consubstantiel. L’événement, ‘la fine pointe de l’événement’ nous laisse stupides, le nez collé à la vitre du train qui déjà s’éloigne. Qu’avons-nous vu ? Notre-Dame qui brûle. Mais simultanément, nous avons-vu l’image de Notre-Dame qui brûlait et puis nous nous sommes vus, nous, chacun dupliqué par son pâle écran dans le soir bleu d’avril, nous nous sommes vus voir l’événement. ‘On voit mieux à la télé’, disait le bistrotier du boulevard Saint-Germain en resservant des bières. On ne peut pas vraiment vivre l’événement parce qu’on est aussitôt pris par son récit, avec ces sms et ces coups de fil fébriles, avec ces télés frénétiques et ces conversations roulantes, synchrones, hétéroguidées : les canadairs, les hélicoptères, les pompiers, la flèche, les chants. Une transe collective. Une célébration sacrée et païenne à la fois.
Qu’avons-nous vu ? Notre-Dame brûle. Le scénario d’un film catastrophe se déclenche sans signe avant coureur, sans message du ciel. D’un coup la légende des siècles se déboîte, le temps se met à avancer par grosses colonnes de millénaires, et les spectateurs terrifiés apprennent que le décor peut disparaître, et eux avec. D’un coup Victor-Hugo est partout, dans les jeunes chrétiens raides agenouillés qui chantent, dans cette vieille prédicatrice qui les défie d’une voix éraillée, dans ces sinistres éclairs rougeoyants dans le ciel, dans ces sombres soldats du feu et dans les larmes des jeunes filles. Comme des badauds égarés sur un plateau de tournage, des touristes américains contemplent cela accoudés au parapet du pont Saint-Louis, en léchant leurs cornets de glace Berthillon. L’observateur circule là-dedans en cherchant quoi dire et il ne trouve rien. Nous sommes tous pris dans le puissant rayonnement immobile de l’événement et contemplons, figés, l’Innommable.
Frappés au cœur par la flèche du temps, nous pantelons, mais il faudrait être formidablement hypocrites pour ne pas reconnaître le secret plaisir, la secrète jubilation. Est-ce la Schadenfreude de voir quelque chose d’admirable qui s’effondre? Ou plutôt, l’enthousiasme du rôle de composition qui nous est prêté ce soir là, l’héroïsme que nous donne le reflet des flammes sur nous, comme une armure de circonstance? La spiritualité d’emprunt que nous confèrent les chants maintenant entonnés à chaque coin de rue autour de la cathédrale? Ou la rage de l’adolescence qu’ils nous rappellent? L’occasion si rare, inespérée, de la grandeur qui nous enfin est proposée? ‘Toutes les choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours qui attendent que nous les secourions. Tous les dragons de notre vie ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux’, écrit Rilke dans ‘Lettres à un jeune poète’. Sommes-nous beaux et courageux?
Et que voyons-nous maintenant? De fantastiques machineries d’imaginaire se sont mises en branle pour contrer le grand déboîtement du temps. Des cathédrales d’opportunité et d’hypocrisie, des contrefeux géants ont surgi miraculeusement de partout. Les politiques s’en saisissent et les agitent avec zèle, l’un au motif de sauver son pays, l’autre de sauver sa ville, tous pour sauver leur peau. Les catholiques prennent leur inénarrable air de faux culs et crient déjà au renouveau de l’Eglise. Voyez ces genoux, voyez ces chants disent-ils. Et, impavides, les grandes fortunes d’ici et d’ailleurs se paient une image marque de qualité supérieure, métaphysique. La réplique des trois empires fut fulgurante. Une réplique capitalistique, pourrait-on dire.
Mais qu’avons-nous encore? Une cathédrale béante, ouverte sur les cieux. Tous crient de concert, en arrière! avec quelques en avant! intempestifs. On exhibe les architectes sur les plateaux télés, qui balbutient, on ne comprend rien à l’architecture de toute façon. Des cuistres parlent de carbone ou de titane. La foule primitive se replie frileusement sur son passé. On va nous bassiner jusqu’à la nuit des temps avec les compagnons du tour de France, les tailleurs de pierre, les fiers chênes du Royaume et Ken Follett. Pour l’heure, la cathédrale est ouverte. L’avenir est un capital douteux en face de l’autre, le prétérit, pour qui tous ont des yeux de Chimène. Mais voire! Nous ne leurrons que notre part la plus archaïque, et singulièrement toujours les mêmes réactionnaires raccornis et à-demi aveugles, par ce tropisme de retour au passé, à la tradition ou à l’Eglise. La tentative même de retour au passé est une futurition, écrit Jankélévitch dans ‘la Nostalgie’. Les descendants mêmes des détracteurs de la flèche de Viollet-le-Duc, par exemple, vont probablement être ceux qui exigent maintenant sa reconstitutionà l’identique. Progressistes et réactionnaires sont passagers du même train, dit encore Jankélévitch, certains de mauvaise grâce, d’autres de bonne grâce. Les uns traînés, les autres freinés. Ils n’entravent ni n’accélèrent sa course. Mais cette course irréversible, elle a comme des à-coups quand éclate brusquement, comme lundi soir, la tectonique de notre temps culturel ou social. Quand éclatent d’un coup l’alpha et l’oméga du monde dans lequel on croyait vivre. Alors il y a cette béance, cet ‘Ouvert’, cette altérité radicale étincelante non encore recouverte, non encore domptée par l’imaginaire instituant de la société. La chute du mur de Berlin, les attentats du 11 septembre sont des événements qui ont été spontanément évoqués au lendemain de l’incendie de Notre-Dame. Ils n’ont pas seulement en commun d’êtres mémorables, de marquer une vie d’homme. Ce sont aussi des moments ou le décor de nos certitudes se déchire, où effroi et espoir se confondent sans mesure, où l’on se sent vivre, dans l’immensité du Temps, pour une fois pas ramené à nos seules dimensions humaines. Lundi soir tout le monde a entendu, pensé ou dit cette phrase : ‘Je ne pensais pas que c’était possible.’ Son corollaire, c’est qu’on ne pensait pas le temps capable, gros de tels bouleversements. Et par là, qu’on ne se savait pas, nous, capables d’y faire face, d’inventer la suite de l’histoire. Le temps est création, surgissement d’altérité, dit Castoriadis. Et nous sommes faits de la même texture que lui. Nous sommes, nous aussi, création et surgissement d’altérité radicalement nouvelle. Nous sommes le fleuve Devenir, nous aussi. L’important n’est pas de savoir si la flèche de Notre-Dame sera en plomb, en kevlar ou en carbone. Ce n’est pas nous qui sommes l’histoire, au point que toute perte comme la toiture de Notre-Dame serait une blessure fatale à notre identité, à nos prétendues ‘racines chrétiennes’ ou que sais-je. C’est l’inverse, c’est l’histoire qui est nous, qui suit nos fluctuations, nos inventions, nos lubies, nos croyances, nos châteaux en Espagne ou nos espoirs. La destruction est féconde dans la mesure où elle nous rend notre destinée, où elle nous force à nous rappeler que c’est nous qui inventons l’histoire. Il nous reste beaucoup de cathédrales à inventer, et l’avenir n’est pas le moindre de nos capitaux. ‘Tant d’aurores n’ont pas encore lui…’