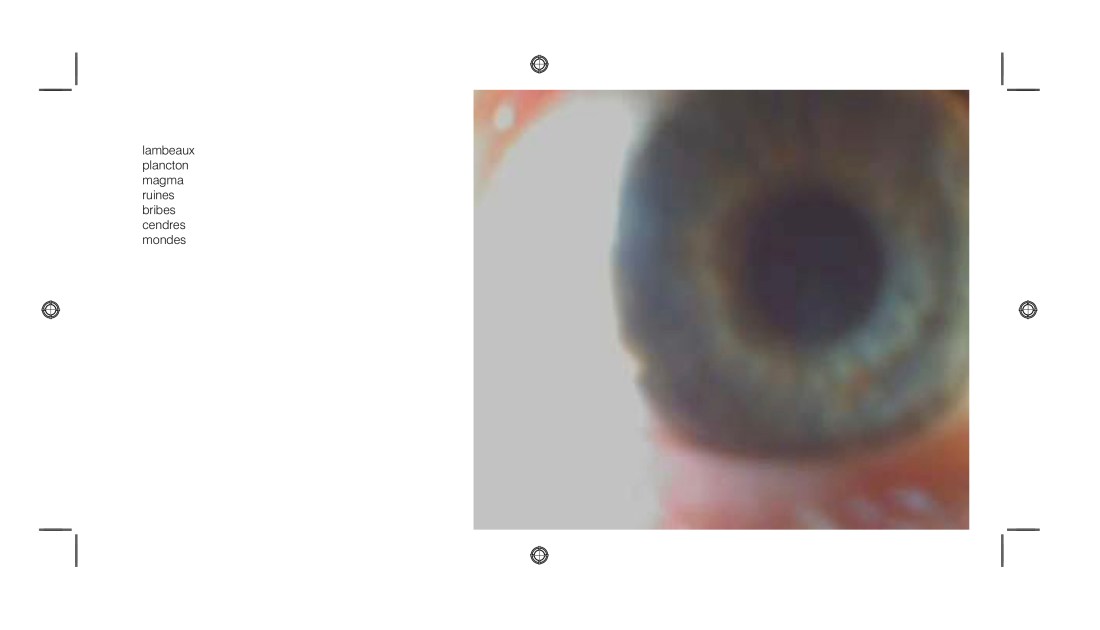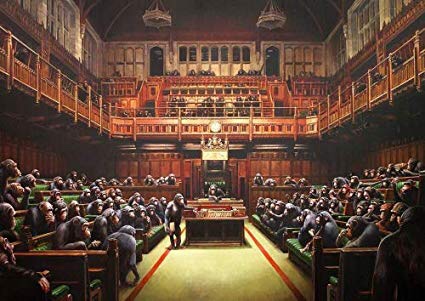‘La représentation n’est pas décalque du spectacle du monde, elle est ce dans et par quoi se lève, à partir d’un moment, un monde’.
Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 1974
Voilà, c’est comme un voyage vers Mars, me dis-je. Ou une sorte d’entraînement, à tout le moins. Clairement, la dimension spatiale nous est chaque jour un peu plus déniée, et le périmètre de la prison rétrécit. Hier, profitant d’un prétexte professionnel douteux, j’ai pu traverser Paris — une dernière fois?– en taxi pour aller livrer des plans à un client. J’ai vu la place de la Concorde déserte, la rue de Rivoli longue et vide. J’ai vu la troupe des joggers dans leur fuite dérisoire, en train de transformer la ville en tapis roulant, en décor de cinéma. Avec leur pas éternellement suspendu, ils prolongent la lumière blanche du bug, de l’explosion silencieuse, du rapt de la réalité. Et au moment de livrer lesdits plans, sur un palier cossu, il y eut une scène cocasse à la John le Carré : pas un mot, des gestes impérieux de mise à distance, un sourire gêné, j’ai fini par jeter l’enveloppe sur le tapis. Au retour, dans la limousine, on pouvait certes apprécier le printemps dans l’air, la douceur du soleil mais c’était bien le retour, la fin de la permission. Chez soi, le mot a pris un sens nouveau. En soi, pourrait-on dire. Cinquante deux mètres carré d’existence, de vie, d’autonomie — une capsule, un vaisseau. L’espace nous est dénié, il nous reste le voyage dans le temps. Deux semaines, quatre, six, huit? On ne sait. Il faut franchir, traverser. Certains y verront un but, d’autres une épreuve, d’autres encore une occasion, une expérience. Une mutation peut-être. Mais en vérité notre rapport au monde, réel, physique, celui que nous regardons avec envie, là juste en face derrière les grilles fermées du parc, ce rapport n’a-t-il pas déjà changé?
Depuis quelques jours, nous avons troqué notre sociabilité pour une autre. Nous sommes à l’heure des apéros Skype et FaceTime, des conference calls, des conversations de groupe sur WhatsApp, des SMS où nous distribuons les emojis en pagaille. Assis à mon nouveau bureau, devant l’ordinateur, seul au neuvième étage avec vue, je suis de plus en plus l’opérateur silencieux de ma traversée, devant la console de commande du vaisseau. Sous mes doigts toutes les touches pour moduler mon rapport aux autres, commander à mes objets connectés, explorer le web et écrire ce texte, en porte-à-faux sur le monde, comme disait Paul Virilio. Ces nouveaux codes, cette nouvelle puissance de l’égo ne sont-ils que temporaires? Comment allons-nous, dans quelques semaines, ré-atterrir? N’est-ce pas aussi que le monde réel dont nous regrettons d’être privés, nous avons passé les dix dernières années à l’arpenter le nez dans notre écran, occupés à le transformer, à le convertir, à le coder en un monde finalement plus compréhensible, plus digéré par nous sous forme numérique? Il y a un plaisir de ce nouveau monde, un plaisir égotique car il nous appartient, il nous obéit. Nous expérimentons, contre notre gré certes mais nous expérimentons peut-être une nouvelle forme de ville. Peut-être que des artefacts spatiaux surgiront bientôt pour continuer de développer ce formidable monde alternatif, pour loger les choses et les gens dans un nouvel ordre. L’effet actuel de dépression, de dépressurisation, de ‘déprégnance ‘ vient du fait que tous les ordres sociaux établis ont disjoncté : l’obligation du travail, de l’école, les codes des rapports sociaux physiques, en premier desquels l’apparence (le jogging, encore). La sidération des premiers jours de confinement vient sûrement de là : elle tient de l’incrédulité d’animaux domestiques qu’on aurait soudainement libérés en plein champ, à ceci près qu’on nous a, nous, enfermés.
La nouvelle puissance, c’est que munis de nos outils prométhéens, de nos outils prothétiques comme disait Freud, nous ne rencontrons plus les anciens ordres et les anciennes obligations, du moins temporairement. La norme sociale, l’Etat même malgré ses efforts désespérés et qui vont devenir de plus en plus autoritaires, ont baissé la garde. L’autonomie, chère à Castoriadis, remplace temporairement et avantageusement l’hétéronomie, la pensée héritée, le gouvernement extérieur de nous pourrait-on dire. ‘Ils se croient en vacances’, se désolent les gouvernants. Oui, plus qu’ils ne le croient, il y a vacance ou béance, il y a brèche dans l’ordre social, dans l’ordonnancement synthétique, hérité de la réalité. C’est tout le paradoxe de la période extraordinaire que nous vivons : enfermés, nous gagnons en portée, en autonomie, en pensée, en puissance. Et à un moment donné, de cette puissance-là, de cette représentation autre du réel avec ses nouveaux codes et ses nouveaux outils et ses nouveaux regards, va se lever un nouveau monde.