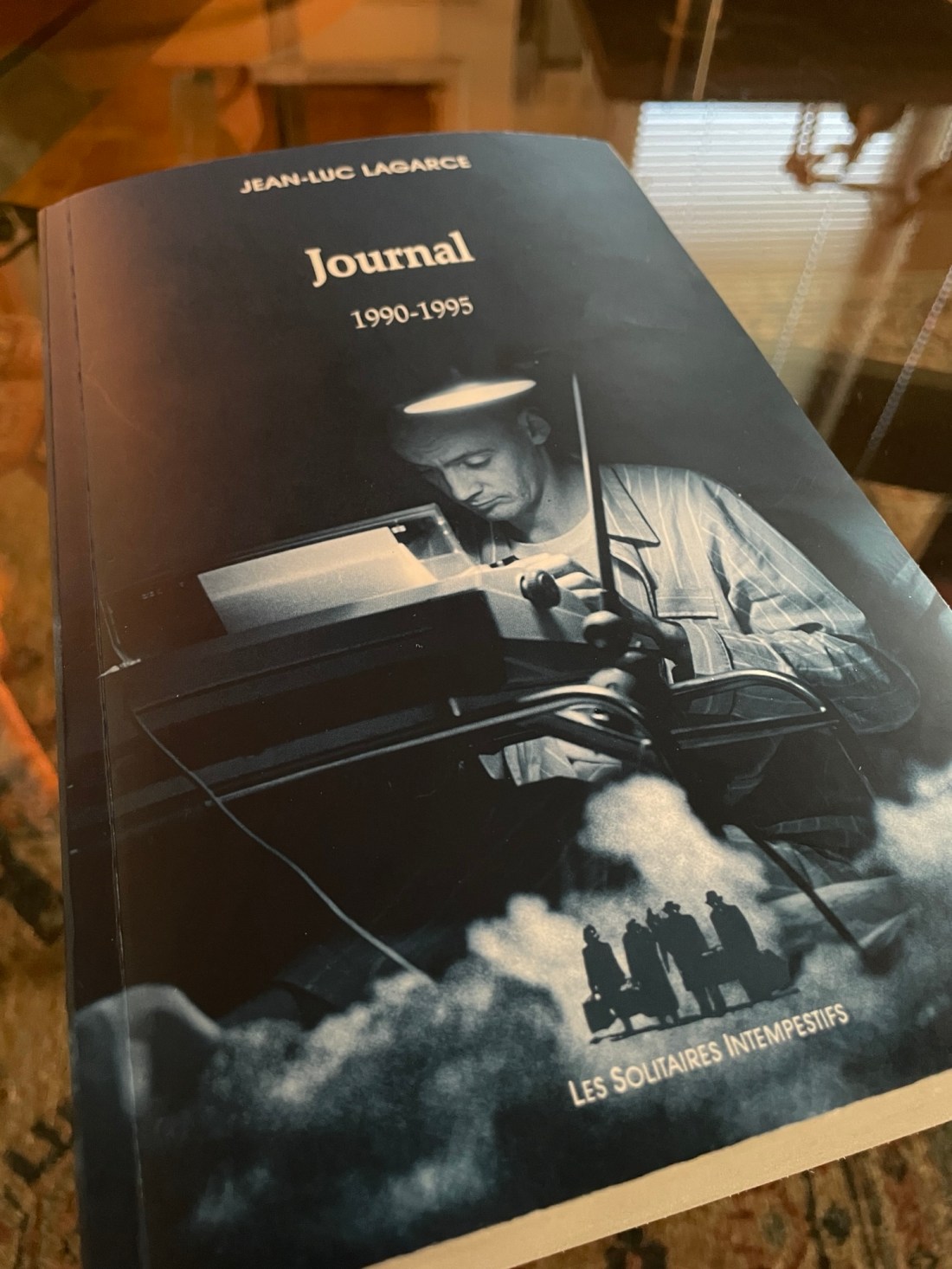Gombrowicz, en décembre, à Mar del Plata, seul dans une grande demeure déserte, dans la tempête et les orages sur la plage de la Quinta, avec l’exemple transperçant de Simone Weil comme emblème. » J’ai conscience, oui, que je suis déjà devenu. Déjà, je suis. Witold Gombrowicz, ces deux mots que je portais comme un vêtement, ils sont, déjà, révolus. Je suis trop. Encore que je puisse accomplir telle ou telle chose imprévue de moi-même, je n’en ai plus envie, non, je ne peux plus vouloir : je suis trop. Au milieu de cet univers infini qui sans cesse bouge et se transforme, sous un ciel indéfinissable, je suis, à jamais, achevé, fini, défini… je suis, et tellement que cela me projette en dehors de la nature. »
—
Bus 115 vers Montreuil à travers Bagnolet. Vendredi matin, temps gris, avec des éclats de lumière. Vers Montreuil, lieu de Berezinas passées, de désillusions, d’amertumes, mais d’aventures encore, dans cette grisaille équanime dont surgissent des formes, des situations, des gens, des inspirations. « Montreuil looks like Belgium », dit Filipo. Oui, avec cet aspect de ville qui ne cherche pas à être belle, et qui souvent l’est. Je regarde par la fenêtre du bus, complétement absorbé par le déroulement des choses, par l’ordre brutal, arbitraire et précis des choses qui a tout du poème. Pelouses livides, matériaux divers, rugueux, gris, comme des tonalités musicales. Je happe aussi les noms ici et là, comme une sorte de plancton poétique. Écrit sur un hangar en ciment gris : » so far » ou « Sofar« . « Plastherm ». « Les Malassis ». Et puis soudain, alors que le bus tourne et s’engage dans une rue toute droite vers l’autoroute A3, une ombre. L’ombre d’un bâtiment incroyable, ou plutôt, un groupe de bâtiments plantés comme des lames dans le ciel, d’une brutalité inouïe, au moins quarante ou cinquante mètres de haut. Je lis « Castor, Pollux, Aurore, Flore ». Plaqué sous les barres, un centre commercial à l’agonie sous son étanchéité, plus gris que le gris encore. C’est comme une épave, une étrave déchirée dans le ciel, comme la souffrance à vif de quelque chose ou de quelqu’un. Avenue de Stalingrad. Je regarde, j’écarquille, le bus passe, franchit l’autoroute toute bardée d’ouvrages d’art, le béton est omniprésent, il est puissant et beau comme sorte de minéralité de fiction, de décor apocalyptique, de chant déchiré. Je descends devant le « groupe scolaire du travail » parmi les chantiers de démolitions et m’engouffre dans les petites rues de Montreuil vers mon rendez-vous. Je sais que la liberté que je prends est conditionnelle, momentanée. Et pourtant je m’abandonne totalement au déroulé des choses, esclave de la faculté pure de voir et de sentir, de découvrir. Un mystère se joue là, sûrement, pour moi seul, un monde autre se dévoile comme dans le livre de Peter Handke, Mon année dans la baie de personne. Hangars. Petits pavillons rongés. Architectures plus ou moins dessinées. Essais, tentatives, chantiers avortés, démolitions en cours. Gris métaphysique, flottant. Je retrouve Moad entre deux rues, flottant lui-aussi, ironique, regardant un bâtiment étrange, sorte de colombage des années quatre-vingt en métal vert. Une espèce de Belgique, oui, après tout, la Belgique de Magritte et Delvaux. Plus tard, après le rendez-vous – retour en voiture avec Moad qui produit une impression toute différente, comme une contre-impression – je regarde ce que peux bien être cette arête invraisemblable que j’ai longée en bus le matin. Je scrute la photo aérienne, et trouve : Les Rigondes, Jean Balladur, 1962-1964, patrimoine du XXème siècle. Jean Balladur, la Grande Motte, l’hôpital de l’Institut Curie aussi. Les Rigondes ont lancé sa carrière et sa réputation, ont obtenu des prix. Réalisation soignée, bas-reliefs dessinés par l’architecte, choix du béton brut, bassins et supermarchés : on a tout oublié de ce temps-là et on n’a aucune idée de la résonance de cette architecture à l’époque, avant sa dégradation et ses restaurations plus ou moins réussies. Deux barres de treize et vingt étages, deux autres de quatre étages. Terrain de tennis, aujourd’hui disparu. Esquisse de supermarché ou de galerie commerciale. Ce que l’on peine aujourd’hui à comprendre, ce qui est a priori impensable, c’est la sûreté, la certitude, la confiance qui faisait dessiner ce genre de choses à un architecte. Conçu en 1957 pour une compagnie d’assurance. Ce n’est pas l’immédiat après-guerre, et il devait bien exister un tissu urbain à cet endroit, quelque chose. Et pourquoi Castor et Pollux, les Dioscures, les enfants de Zeus et de Léda ? Il y avait certainement l’assurance, la confiance, la certitude – le fait d’habiter dans une signification imaginaire sociale, comme dit Castoriadis, qui a totalement disparu. Il ne nous reste plus que l’architecture, la trace physique qui s’abime dans le temps, le sens, on l’a perdu comme pour les pyramides de Gizeh ou les temples aztèques.
—
Plus tard dans la journée, je rencontre Martine K., historienne du XXème arrondissement qui me donne des conseils pour la recherche sur les Bains et m’encourage. Chez cette dame âgée je sens encore brûler le feu de l’intérêt pour l’histoire et l’aventure, la passion de la connaissance, l’habitude de pousser des portes et d’écrire. Plus tard encore, réunion pour les travaux du 165 rue de Belleville, la plupart des copropriétaires, grassement satisfaits d’eux-mêmes, ignorent qu’ils vivent depuis des années au-dessus du regard Saint-Louis, dit chambre du chirurgien, qui date du Moyen Âge et du XVIIIème siècle. Malicieuse, Ray s’est bien gardée de le leur dire mais à ma demande elle produit une photo, sait qui s’en occupe, etc. Les autres mangent leurs cacahouètes et boivent leur bière. Détective obscur, à défaut d’être sauvage, j’aimerais que des liens s’établissent entre les Bains de la Renaissance et le chantier de la Renaissance, entre le n°174 et le 162 rue de Belleville, j’aimerais que ces réseaux souterrains m’emmènent dans une aventure, encore une, pourquoi pas, faite de rencontres et d’écueils, d’excitation, de lendemains.