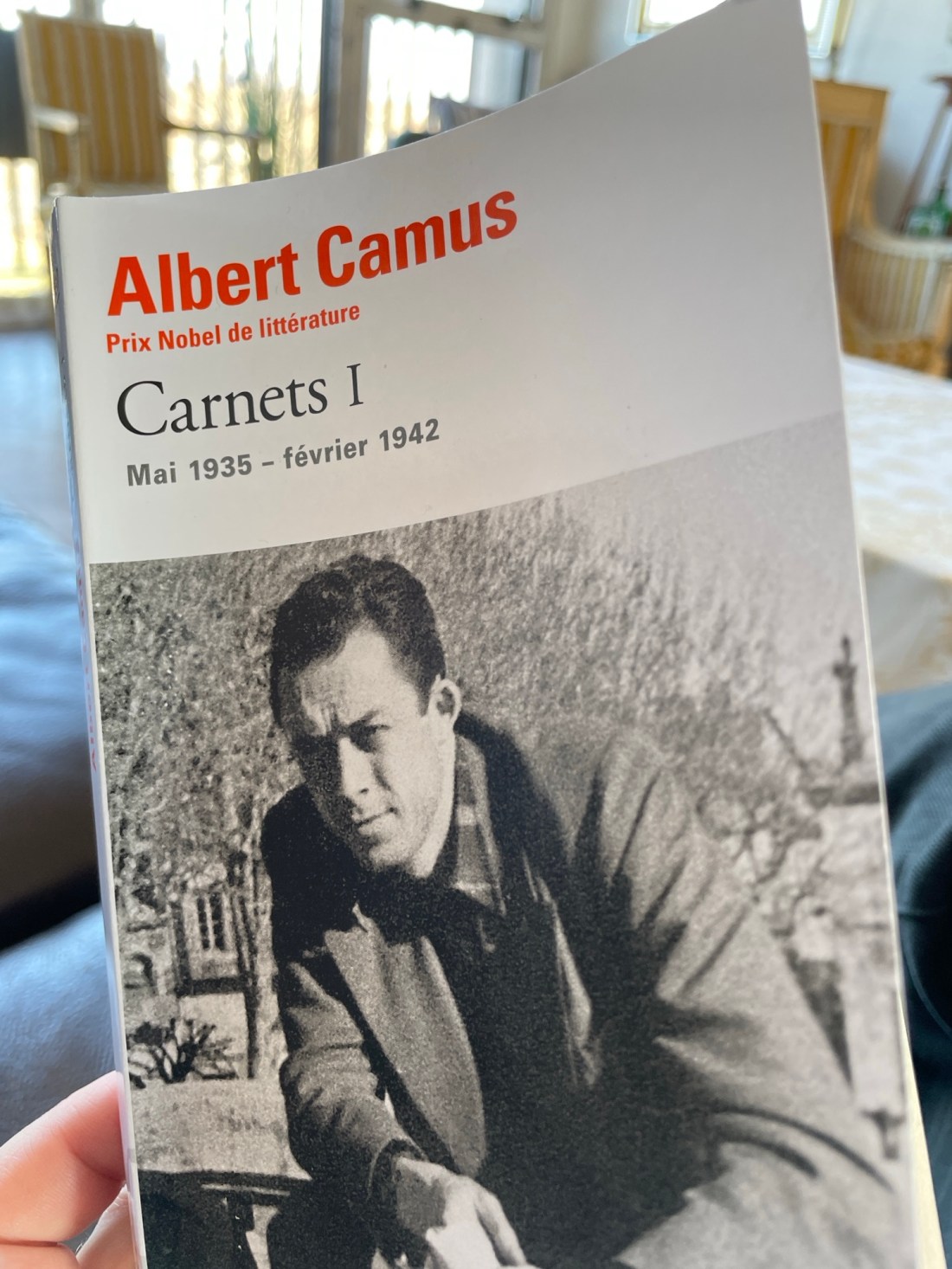« Après le déjeuner, je me suis ennuyé un peu et j’ai erré dans l’appartement. Il était commode quand maman était là. Maintenant il est trop grand pour moi et j’ai dû transporter dans ma chambre la table de la salle à manger. Je ne vis plus que dans cette pièce, entre les chaises de paille un peu creusées, l’armoire dont la glace est jaunie, la table de toilette et le lit de cuivre. Le reste est à l’abandon. Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j’ai pris un vieux journal et je l’ai lu. J’y ai découpé une réclame des sels Kruschen et je l’ai collée dans un vieux cahier où je mets les choses qui m’amusent dans les journaux. Je me suis, aussi lavé les mains et, pour finir, je me suis mis au balcon.
Ma chambre donne sur la rue principale du faubourg. L’après-midi était beau. Cependant, le pavé était gras, les gens rares et pressés encore. C’étaient d’abord des familles allant en promenade, deux petits garçons en costume marin, la culotte au-dessous du genou, un peu empêtrés dans leurs vêtements raides, et une petite fille avec un gros nœud rose et des souliers noirs vernis. Derrière eux, une mère énorme, en robe de soie marron, et le père, un petit homme assez frêle que je connais de vue. Il avait un canotier, un nœud papillon et une canne à la main. En le voyant avec sa femme, j’ai compris pourquoi dans le quartier on disait de lui qu’il était distingué. Un peu plus tard passèrent les jeunes gens du faubourg, cheveux laqués et cravate rouge, le veston très cintré, avec une pochette brodée et des souliers à bouts carrés. J’ai pensé qu’ils allaient aux cinémas du centre. C’était pourquoi ils partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort.
Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n’y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. Le ciel était pur mais sans éclat au-dessus des ficus qui bordent la rue. Sur le trottoir d’en face, le marchand de tabac a sorti une chaise, l’a installée devant sa porte et l’a enfourchée en s’appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams tout à l’heure bondés étaient presque vides. Dans le petit café : « Chez Pierrot », à côté du marchand de tabac, le garçon balayait de la sciure dans la salle déserte. C’était vraiment dimanche.
J’ai retourné ma chaise et je l’ai placée comme celle du marchand de tabac parce que j’ai trouvé que c’était plus commode. J’ai fumé deux cigarettes, je suis rentré pour prendre un morceau de chocolat et je suis revenu le manger à la fenêtre. Peu après, le ciel s’est assombri et j’ai cru que nous allions avoir un orage d’été. Il s’est découvert peu à peu cependant. Mais le passage des nuées avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui l’a rendue plus sombre. Je suis resté longtemps à regarder le ciel.
À cinq heures, des tramways sont arrivés dans le bruit. Ils ramenaient du stade de banlieue des grappes de spectateurs perchés sur les marchepieds et, les rambardes. Les tramways suivants ont ramené les joueurs que j’ai reconnus à leurs petites valises. Ils hurlaient et chantaient à pleins poumons que leur club ne périrait pas. Plusieurs m’ont fait des signes. L’un m’a même crié : « On les a eus. » Et j’ai fait : « Oui », en secouant la tête. À partir de ce moment, les autos ont commencé à affluer.
La journée a tourné encore un peu. Au-dessus des toits, le ciel est devenu rougeâtre et, avec le soir naissant, les rues se sont animées. Les promeneurs revenaient peu à peu. J’ai reconnu le monsieur distingué au milieu d’autres. Les enfants pleuraient ou se laissaient traîner. Presque aussitôt, les cinémas du quartier ont déversé dans la rue un flot de spectateurs. Parmi eux, les jeunes gens avaient des gestes plus décidés que d’habitude et j’ai pensé qu’ils avaient vu un film d’aventures. Ceux qui revenaient des cinémas de la ville arrivèrent un peu plus tard. Ils semblaient plus graves. Ils riaient encore, mais de temps en temps, ils paraissaient fatigués et songeurs. Ils sont restés dans la rue, allant et venant sur le trottoir d’en face. Les jeunes filles du quartier, en cheveux, se tenaient par le bras. Les jeunes gens s’étaient arrangés pour les croiser et ils lançaient des plaisanteries dont elles riaient en détournant la tête. Plusieurs d’entre elles, que je connaissais, m’ont fait des signes.
Les lampes de la rue se sont alors allumées brusquement et elles ont fait pâlir les premières étoiles qui montaient dans la nuit. J’ai senti mes yeux se fatiguer à regarder ainsi les trottoirs avec leur chargement d’hommes et de lumières. Les lampes faisaient luire le pavé mouillé, et les tramways, à intervalles réguliers, mettaient leurs reflets sur des cheveux brillants, un sourire ou un bracelet d’argent. Peu après, avec les tramways plus rares et la nuit déjà noire au-dessus des arbres et des lampes, le quartier s’est vidé insensiblement, jusqu’à ce que le premier chat traverse lentement la rue de nouveau déserte. J’ai pensé alors qu’il fallait dîner. J’avais un peu mal au cou d’être resté longtemps appuyé sur le dos de ma chaise. Je suis descendu acheter du pain et des pâtes, j’ai fait ma cuisine et j’ai mangé debout. J’ai voulu fumer une cigarette à la fenêtre, mais l’air avait fraîchi et j’ai eu un peu froid. J’ai fermé mes fenêtres et en revenant j’ai vu dans la glace un bout de table ou ma lampe à alcool voisinait avec des morceaux de pain. J’ai pensé que c’était toujours un dimanche de tiré, que maman était maintenant enterrée, que j’allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n’y avait rien de changé. »