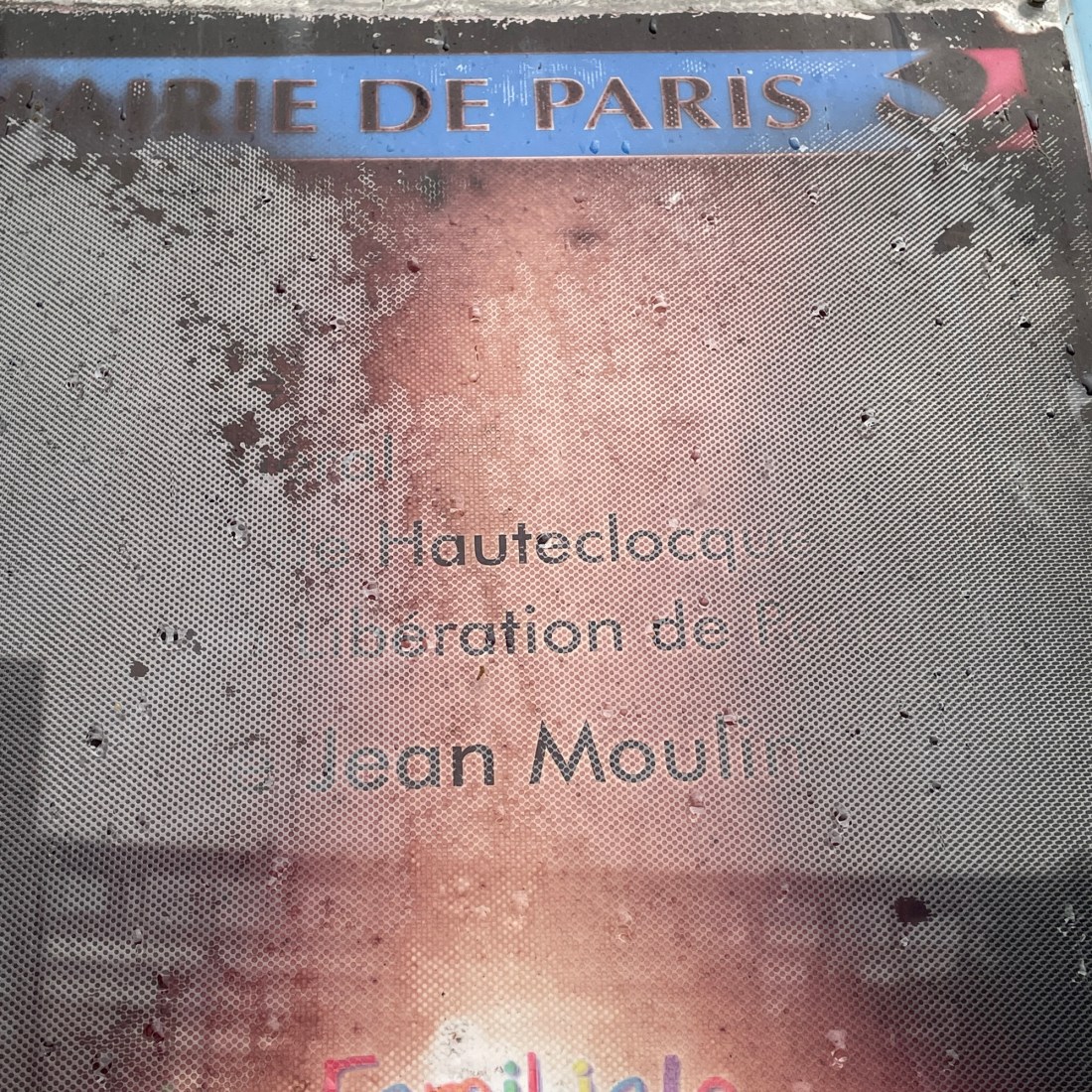À quoi cela me sert-il d’avoir vu, par exemple, vingt-cinq fois “L’Armée des Ombres” de Melville (1968) et que une, et encore par hasard hier après-midi, “Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles” de Chantal Akerman (1975)? À rien. Je suis un benêt qui repasse dans les mêmes ornières, qui ne voit rien.
La mécanique. Le clignotant bleu en permanence dans le salon, on ne saura jamais ce que c’est, une enseigne, une métaphore de la police, de la répression : on n’aura jamais aucune explication sur rien, aucune complaisance de narration, aucun surlignage psychologique, aucune voix off, rien. Rien que la froideur implacable du dispositif, sa géométrie. Il faut avoir vingt-quatre ans et la révolution qui coule dans ses veines pour faire quelque chose d’aussi radical. Kafka. Le Kafka du “Seau de charbon”, de “Devant la loi”, du “Chateau”. Et Delphine Seyrig, la plus belle femme du cinéma, emploi magnifique, en mission. Le violoncelle humain. Le regard absent, comme une somnambule, “aloof”, distante, perdue, sublime. Le demi-sourire ou juste le galbe des lèvres comme une proue qui fend le Néant. Le film n’est pas sans tendresse – avec les liens resserrés d’une veuve et de son fils. Même dans l’ascenseur elle s’échappe. Elle ne regarde personne surtout pas elle-même.
Le langage est infecté alors il faut le détruire, face au dispositif il faut mettre en place un dispositif plus puissant et plus pragmatique et plus froid encore pour le détruire : c’est un détachement frontal, clinique, génial, implacable. Dans le making-off tourné en noir et blanc par Samy Frey on voit Chantal Akerman rire pendant les interminables répétitions dans la cuisine : ad absurdum, encore et encore, les casseroles, la chaise, la table, l’évier, le café, la viande.
Les portes, les grincements, les plans, les interrupteurs : Jeanne Dielman éteint et rallume la lumière de chaque pièce de l’appartement où elle passe comme une machine folle, clic, clac et cela met une tension dramatique même s’il n’y en a pas. Son Hitchcock à elle, a-t-elle dit avec humour, sera de savoir si la pomme de terre brûle. On peut regarder dans les coins des plans. Tout est orthogonal, euclidien. La perspective comme à l’école de cinéma. Le dispositif. Delphine Seyrig qui sort du champ, il ne reste plus que des bouts de son corps, elle apparaît, disparaît, c’est fascinant, ça dure trois heures vingts.
Ça fait penser un peu à “Ali” de Fassbinder. Angst essen Seele auf… Le quotidien sévère, austère. La petite affichette “Spaar Energie” à la poste, je suis sûr qu’elle l’a fait exprès. C’est sûr qu’on n’est pas dans Michelangelo Antonioni. 1975. Qu’est-ce qu’il y avait au même moment? Delon. Belmondo. Clint Estwood. N’en jetez plus.
L’assommant du quotidien. Manger, dormir, se laver. Chaque jour. Et les femmes sont responsables de tout cela par on ne sait quelle damnation. L’ennui. Le film est mortellement ennuyeux mais au sens de Du Bellay, ça veut dire tourment, désespoir.
Demandeurs de divertissement, passez votre chemin.
La blouse. Une personne seule est une machine monstrueuse parce que la société continue d’agir en elle automatiquement comme un programme de machine à laver. La répétition. Le temps est complètement rempli, et cyclique. In extenso. Dans la longueur. Sans pitié. Comme dans un rêve. Les opérateurs silencieux, les agents (mais de quelle force?) comme cet employé de banque blême qui tamponne comme Kafka le Choucas tamponnait. Melville disait qu’il “dilatait” quand il ralentissait une scène jusque dans ses moindres détails, de manière interminable, pour faire monter la tension avec un soin maniaque. Akerman, elle, elle relate. La scène des escalopes. Elle veut purement et simplement tout faire exploser. C’est une révolutionnaire. Akerman c’est vraiment un oeil. Qu’elle déplace posément comme sa caméra, toujours plan fixe. Rien ne lui résiste. Le monde est à elle.
A quoi pensait Delphine Seyrig en tournant ça? Les comptes. L’obéissance. Le demi-sourire de Delphine Seyrig. La toilette. Le miroir. Soi-même comme une chose extérieure. Juste un objet du monde. Le totalitaire du quotidien. Ces gestes répétés pour prendre les affaires des hommes qu’elle reçoit. Une condition ancillaire cachée dans le monstrueux du quotidien. Une condition d’esclave.
Cloisons étanches. Portes. Portes. Portes. Quelque chose d’absolument monstrueux est caché derrière le quotidien. Too enormous to be seen, nor said.
Besoin de s’étourdir. Comme les boeufs.
Les camps. Les camps où la répétition des mênes gestes chaque jour était la condition même de la survie. Tous les soirs à la même heure mère et fils écoutent la radio un moment. Que dit la chanson? « Trop de choses m’ont blessée dont le souvenir va s’effacer. Je préfère ne jamais, jamais, jamais, jamais y repenser.»
L’architecture. Les pièces. La folie. Est-ce que la folie est dans le dérèglement ou dans la règle? La soumission à un ordre invisible et omniprésent. La coutume. La solitude. Ce à quoi il ne faut pas toucher. Ce à quoi il ne faut même pas penser. Le nomos.
Les passes. La serviette sur le lit qui est l’équivalent de la blouse des tâches ménagères.
Mais où donc vont Jeanne et son fils le soir? Dans la nuit noire saturée de lumières comne dans Taxi Driver? Où? On ne saura pas. Ce film plein de superbe contient le mystère le plus noir, le plus pur.
La farce. La matière. La viande. La vie.
Machine déréglée. Puissante. Vide. Perdue.
Aliénation. Des micro-décisions, des micro-actions à un niveau de complexité ou de simplicité juste suffisant pour être débilitant, pour manger toute vie, pour écraser l’individu.
L’inanité de l’enfant, et de la mère. L’humanité réduite à l’état de margarine.
Chantal Akerman : « C’est un film sur l’espace et le temps et sur la façon d’organiser sa vie pour n’avoir aucun temps libre, pour ne pas se laisser submerger par l’angoisse et l’obsession de la mort ».
—-
http://www.universcine.com/films/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles